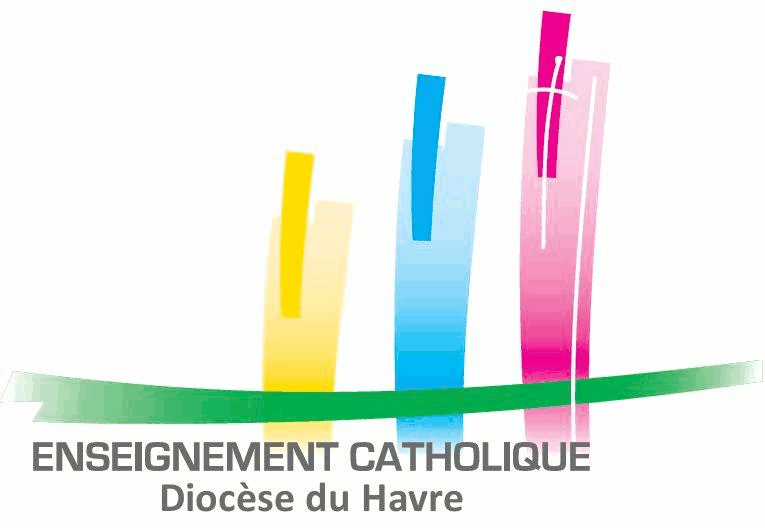Les 5èmes B à la découverte du Moyen-Age
Lundi 2 novembre, les élèves de 5ème B ont fait la rencontre d’Emilie Hamel, animatrice pour l’association Touches d’histoire. Avec toute la passion qui les anime, elles ont su leur faire vivre une époque encore inconnue pour eux : Le Moyen Age.
L’architecture religieuse au Moyen-âge

 Le matin, Emilie les a entraînés dans l’univers grandiose des églises et cathédrales. L’architecture médiévale en Occident peut être divisée en trois périodes aux styles différents : l’architecture préromane, l’architecture romane et l’architecture gothique.
Le matin, Emilie les a entraînés dans l’univers grandiose des églises et cathédrales. L’architecture médiévale en Occident peut être divisée en trois périodes aux styles différents : l’architecture préromane, l’architecture romane et l’architecture gothique.
 L’architecture romane
L’architecture romane
Elle apparaît dans l’Occident chrétien aux XIe et XIIe siècles.Les architectes se sont inspirés des techniques de l’Antiquité (Rome antique) d’où le nom de style « roman ».
Emilie a illustré ses explications par un diaporama. Les églises romanes sont généralement petites et ont un plan en croix latine. Elles sont construites en pierres et non en bois par crainte des incendies. Elles ont toutes une voûte en berceau en pierre car grâce à son poids et sa forme elle exerce une force verticale vers le sol et une force horizontale qui maintient la structure. Pourtant, des contreforts sont ajoutés car les murs ont tendance à s’écarter et sans eux la voûte risquerait de s’effondrer. La voûte est également consolidée par un arc doubleau entre l’abside et le cœur. Pour la soutenir, les murs doivent donc être épais et percés seulement de fenêtres étroites, ce qui explique que les églises romanes soient sombres.
Emilie n’hésite pas à mimer avec les élèves pour mieux comprendre les techniques.
 L’architecture gothique
L’architecture gothique
Elle succède à l’architecture romane. Elle voit le jour en France, vers le milieu du XIIe siècle.
Chacun a pu remplir son dossier de toutes les informations fournies. Le style gothique se caractérise en architecture par l’usage de l’arc brisé et de la clé d’ôgive, qui offrent la possibilité de construire des cathédrales plus hautes que les églises romanes. Ainsi, cette nouvelle architecture se rapproche du ciel, ce qui permet en quelque sorte aux fidèles de se rapprocher de Dieu. C’est aussi pour cela que les petites fenêtres sont remplacées par des vitraux qui laissent plus largement entrer la lumière dont manquaient les édifices religieux romans.
Mais toutes ces explications nécessitent une mise en pratique ! Aussi les élèves de 5ème B ont pu s’exercer sur les techniques de construction de l’époque.
La visite de l’église de Montivilliers
L’après-midi, nous nous sommes rendus en train jusqu’à Montivilliers. Pour certains c’était la première fois qu’ils empruntaient le « Lézarde Express Régional » ! La première fois aussi qu’ils découvraient la ville de Montivilliers. Emilie nous attendait sur le quai de la Gare pour nous emmener visiter l’abbatiale.
L’abbaye de Montivilliers est un monastère féminin fondé vers 684. Ce monastère sera complètement détruit par les Vikings au IXe siècle. L’abbaye est relevée en 1025 quand Richard II de Normandie la place sous la dépendance de l’abbaye de Fécamp, cette fois avec des hommes. Le 13 janvier 1035 lors d’une assemblée tenue à Fécamp, le duc Robert le Magnifique donne son autonomie au monastère, qui redevient une abbaye de femmes, au bénéfice de sa tante Béatrice.
Dans la seconde moitié du XIe siècle, les travaux de construction de la grande église abbatiale, excellent témoin de l’architecture normande à l’époque de Guillaume le Conquérant. Au XVe siècle, la paroisse Saint-Sauveur, qui avait reçu les sept premières travées de la nef, fit abattre son côté nord, pour la doubler avec un large vaisseau gothique.
Mais pour la visite, les élèves de 5ème B ont décidé de s’arrêter sur l’architecture de l’église abbatiale.
Le plan primitif de l’église du XIe siècle, de type bénédictin, a été modifié au XVe siècle. À la croisée, l’église a toutefois conservé un monumental clocher de la fin du XIe siècle.
La façade date de la première moitié du XIIe siècle. Elle devait comporter initialement deux tours, comme les églises de Jumièges ou de Boscherville, mais seule celle du nord a subsisté. Au-dessus du portail roman, une grande fenêtre de style gothique a été percée au XIVe siècle.

 Dans la nef, seul le côté sud, restauré au XIXe siècle, est encore roman. De style gothique flamboyant, la nef est éclairée par les grandes fenêtres de six chapelles contiguës.
Dans la nef, seul le côté sud, restauré au XIXe siècle, est encore roman. De style gothique flamboyant, la nef est éclairée par les grandes fenêtres de six chapelles contiguës.

 À la croisée, une voûte du XVIIe siècle masque la voûte du XIIe siècle. Les bras du transept sont couverts de voûtes d’ogives de style archaïque, dépourvues de clefs, séparées par un bandeau décoré de bâtons brisés. L’arc en plein cintre qui ouvrait sur l’absidiole sud montre vingt claveaux sculptés de scènes anecdotiques ou d’animaux stylisés.
À la croisée, une voûte du XVIIe siècle masque la voûte du XIIe siècle. Les bras du transept sont couverts de voûtes d’ogives de style archaïque, dépourvues de clefs, séparées par un bandeau décoré de bâtons brisés. L’arc en plein cintre qui ouvrait sur l’absidiole sud montre vingt claveaux sculptés de scènes anecdotiques ou d’animaux stylisés.
 Le chœur, profond de trois travées et très modifié au XVIIe siècle, laisse encore deviner sa structure romane primitive, notamment dans les hautes colonnes qui marquaient le départ de l’hémicycle de l’abside.
Le chœur, profond de trois travées et très modifié au XVIIe siècle, laisse encore deviner sa structure romane primitive, notamment dans les hautes colonnes qui marquaient le départ de l’hémicycle de l’abside.

 Nous ne pouvions pas terminer cette visite sans aller admirer le cloître de l’abbatiale !
Nous ne pouvions pas terminer cette visite sans aller admirer le cloître de l’abbatiale !
 Nous sommes repartis en direction de la gare.
Nous sommes repartis en direction de la gare.
Un trajet calme et reposant pour chacun après cette belle balade au cœur de l’histoire médiévale.
L’enfance au Moyen-âge
Le lendemain, Emilie est revenue au Collège nous parler de l’enfance au Moyen-Âge.
La famille de la fin du Moyen Âge est une famille nombreuse. Son modèle est celui du noyau conjugal avec plusieurs enfants, jusqu’à huit ou dix.


Encore une fois, l’éducation et l’instruction ne sont pas les mêmes pour un enfant de seigneur et un enfant de paysan ou de petit artisan.
– Chez les seigneurs, l’instruction de l’enfant commence à partir de 7 ans.
A cet âge, il est confié à un précepteur, sorte de professeur particulier, qui lui enseigne l’essentiel, c’est-à-dire : lire, écrire et compter. Dans les familles les plus riches et les plus cultivées, l’enfant peut apprendre le latin.
Le jeune seigneur reçoit également une éducation religieuse. Il doit apprendre toutes ses prières et connaître la Bible. L’instruction peut également être assurée par les religieux qui se chargent au sein de l’abbaye de dispenser les savoirs indispensables.
Entre 12 et 14 ans, il devient écuyer d’un seigneur ami. C’est déjà la fin de son enfance !
– Chez les paysans ou les artisans, l’enfant a une vie tout à fait différente.
Dans une famille paysanne, le garçon se lève très tôt pour aider son père aux champs. Il garde aussi le bétail, ramasse du bois et chasse les oiseaux et les lapins. La fillette, quant à elle, aide sa maman à la maison. Elle épluche les légumes, nourrit les poules et les canards, et va chercher de l’eau.
Le fils ou la fille d’artisan apprend très tôt le métier de ses parents en les regardant travailler. Cependant, dans certaines régions, les artisans n’ont pas le droit de faire travailler leurs enfants avant un certain âge. Ainsi, les potiers de Bourgogne, par exemple, ne peuvent pas faire travailler leurs fils ou leurs filles avant 10 ans.
Entre 10 et 12 ans, l’enfant entre en apprentissage. Les garçons comme charpentier, sabotier, tonnelier, les filles comme couturière, lingère ou servante.
Pour eux aussi, l’enfance est terminée. Ils sont maintenant considérés comme des adultes.
Ce n’est pas forcément drôle la vie d’enfant au Moyen Age, n’est-ce pas ?
Les jeux et les jouets au Moyen Age :
Il existe tout de même au Moyen Age de nombreux jouets pour les enfants. Les garçons se fabriquent dans une écorce d’arbre de petits bateaux qu’ils font naviguer sur les mares ou les rivières, ou encore des charrettes qu’ils tirent eux-mêmes.
Les petits garçons de la noblesse imitent leur père avec des épées ou des lances en bois. Les petites filles peuvent jouer avec des poupées en chiffon ou en porcelaine. De manière générale, la nature est un formidable terrain de jeu. On joue aussi à plusieurs à des jeux qui existent encore à ton époque : cache–cache, les quatre-coins, colin-maillard, saute-mouton.
Nous avons testé quelques jeux de l’époque ! Bien loin de nos consoles de jeux !



 Alors merci Emilie pour cette jolie balade à l’époque du Moyen Âge !!!
Alors merci Emilie pour cette jolie balade à l’époque du Moyen Âge !!!
Visite du Havre avec la maison du Patrimoine
Lundi 5 octobre, les élèves de 6e et de 5e Culture et Patrimoine sont allés à la découverte de l’histoire de la ville.
A 8h30, les élèves ont pris le tramway pour retrouver les guides de la maison du patrimoine. Le temps était gris mais même si la pluie ne semblait pas venir nous étions tous munis de notre parapluie.
Les guides ont réparti les élèves en deux groupes : Mme Rioult et Mme Delarue sont parties à droite avec les 6èmes tandis que Mme Heurtaux et Mme Levitre se sont dirigés tout droit vers la rue de Paris avec les 5èmes. Les guides nous ont fait découvrir alors le début de l’histoire de la ville.
Le 8 octobre 1517, François Ier signe la charte de fondation du port dont les plans sont confiés d’abord au vice-amiral Guyon le Roy. La « grosse tour » en défend l’entrée. Malgré les difficultés liées au terrain marécageux et aux tempêtes, le port du Havre accueille ses premiers navires en octobre 1518. Le roi se déplace lui-même en 1520 et donne aux havrais ses propres armoiries constituées d’une salamandre. La fonction militaire est aussi encouragée : Le Havre est un des points de rassemblement de la flotte française pendant les guerres. Des navires partent également pêcher la morue à Terre-Neuve.
Au bout de la rue de Paris, nous observons le port. Le guide nous explique l’emplacement de la tour François 1er, élément essentiel des remparts de la ville lors de sa fondation.
 Le Nouveau Monde attire les aventuriers et quelques-uns partent du Havre, comme Villegagnon qui fonde une colonie au Brésil (Fort-Coligny) en 1555. À la fin du XVIe siècle, la contrebande prend son essor et Le Havre voit arriver des produits américains comme des cuirs, du sucre et du tabac.
Le Nouveau Monde attire les aventuriers et quelques-uns partent du Havre, comme Villegagnon qui fonde une colonie au Brésil (Fort-Coligny) en 1555. À la fin du XVIe siècle, la contrebande prend son essor et Le Havre voit arriver des produits américains comme des cuirs, du sucre et du tabac.
Nous remontons ensuite la rue de Paris pour rejoindre la cathédrale Notre Dame. Le guide poursuit ses explications.

 En 1525, une tempête provoque la mort d’une centaine de personnes, la destruction de 28 bateaux de pêche et de la chapelle Notre-Dame. En 1536, cette dernière est reconstruite en bois avec des piliers en pierres sous la direction de Guillaume de Marceilles. Une tour gothique coiffée d’une grande flèche octogonale est ajoutée en 1540.
En 1525, une tempête provoque la mort d’une centaine de personnes, la destruction de 28 bateaux de pêche et de la chapelle Notre-Dame. En 1536, cette dernière est reconstruite en bois avec des piliers en pierres sous la direction de Guillaume de Marceilles. Une tour gothique coiffée d’une grande flèche octogonale est ajoutée en 1540.
Nous prenons à droite en direction du bassin du Roy puis du bassin du commerce. Le guide nous montre alors sur un plan d’époque les limites de la ville.

 La même année François Ier confie le projet d’urbanisme et de fortification à l’architecte italien Girolamo Bellarmato. Celui-ci a les pleins pouvoirs et organise le quartier Saint-François selon des normes précises (plan orthogonal, limitation de la hauteur des maisons, etc.).
La même année François Ier confie le projet d’urbanisme et de fortification à l’architecte italien Girolamo Bellarmato. Celui-ci a les pleins pouvoirs et organise le quartier Saint-François selon des normes précises (plan orthogonal, limitation de la hauteur des maisons, etc.).
Nous apprenons alors que Le Havre a été touché par les guerres de religion, qui ont encore modifié la ville.
Le 8 mai 1562, les réformés prennent la ville, pillent les églises et expulsent les catholiques. Redoutant une contre-attaque des armées royales, ils se tournent vers les Anglais qui leur envoient des troupes. Les occupants construisent des fortifications en vertu du traité d’Hampton Court. Les troupes de Charles IX attaquent Le Havre et les Anglais sont finalement chassés le 29 juillet 1563. Le fort bâti par les Anglais est détruit et la tour de Notre-Dame est abaissée sur les ordres du roi de France. Celui-ci ordonne la construction d’une nouvelle citadelle qui est achevée en 1574. De nouvelles fortifications sont mises en place entre 1594 et 1610.
Devant nous au loin, nous apercevons la maison de l’armateur. Et là, c’est une triste période de la ville que nous découvrons.
Le Havre affirme sa vocation maritime et internationale au cours du XVIIe siècle : la Compagnie de l’Orient s’y installe dès 1643. On importe d’Amérique des produits exotiques (sucre, coton, tabac, café et diverses épices). La traite des Noirs enrichit les négociants locaux, surtout au XVIIIe siècle. Avec 399 expéditions négrières aux XVIIe et XVIIIe siècles, Le Havre figure au troisième rang des ports français ayant pratiqué la traite atlantique, derrière Nantes et La Rochelle.
Entre 1789 et 1793, le port du Havre est le deuxième en France, après celui de Nantes. Le commerce triangulaire se poursuit jusqu’à la guerre et l’abolition de la traite. Le port reste toujours un enjeu stratégique à cause du commerce des céréales (ravitaillement de Paris) et de sa proximité avec l’ennemi britannique.
Nous poursuivons notre chemin pour arriver au square St Roch.
 Au début du XVIe siècle, l’endroit était occupé par des bâtiments accueillant les pestiférés. Il existe alors un lazaret et une chapelle. dédiée à saint Roch : saint Roch était le saint auquel les Hommes du Moyen Âge adressaient leur prières.
Au début du XVIe siècle, l’endroit était occupé par des bâtiments accueillant les pestiférés. Il existe alors un lazaret et une chapelle. dédiée à saint Roch : saint Roch était le saint auquel les Hommes du Moyen Âge adressaient leur prières.
Pour finir ce périple dans la ville, le guide nous explique l’essor de la ville au XIXe siècle.
Les effets de la révolution industrielle sont de plus en plus visibles au Havre : la première drague à vapeur est utilisée en 1831. Les chantiers de construction navale se développent avec Augustin Normand. Frédéric Sauvage met au point ses premières hélices au Havre en 1833. Le chemin de fer arrive en 1848 et permet de désenclaver Le Havre. Les docks sont construits à la même époque, de même que des magasins généraux.
À la veille de la Première Guerre mondiale, Le Havre est le premier port européen pour le café ; il importe quelque 250 000 tonnes de coton et 100 000 tonnes de pétrole.
La matinée se termine et nous sommes exténués. Le pique-nique dans le jardin de l’hôtel de ville est le bienvenue. Heureusement nous avons tous terminés notre repas lorsque la pluie commence à se faire sentir. Nous nous abritons un temps sous le préau du jardin d’enfants avant de repartir pour la visite guidée de l’après-midi.
Nous retrouvons alors deux nouveaux guides pour la balade historique. Au programme : Le Havre de la reconstruction.
Le Havre subit 132 bombardements planifiés par les Alliés au cours de la guerre. En 1942, le quartier de la gare est détruit. Plus tard, à la Libération, les nazis détruiront également les infrastructures portuaires et couleront des navires avant de quitter la ville. Mais les destructions les plus importantes surviennent les 5 et 6 septembre 1944 lorsque les avions anglais bombardent le centre-ville et le port pour affaiblir l’occupant dans le cadre de l’Opération Astonia. En sept jours, les bombardiers de la Royal Air Force ont opéré sur le Havre un peu plus de 2000 sorties et ont déversé quelques 10 000 tonnes de bombes.
 Nous avons du mal à imaginer une telle destruction ! Le guide nous explique alors les étapes de la reconstruction.
Nous avons du mal à imaginer une telle destruction ! Le guide nous explique alors les étapes de la reconstruction.

 Au printemps 1945, le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme confie le projet de reconstruction du centre-ville du Havre à l’atelier Perret. Il souhaite faire table rase des anciennes structures et appliquer les théories du classicisme structurel. Le matériau retenu est le béton et le plan général est une trame orthogonale. Officiellement, la reconstruction s’achève au milieu des années 1960.
Au printemps 1945, le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme confie le projet de reconstruction du centre-ville du Havre à l’atelier Perret. Il souhaite faire table rase des anciennes structures et appliquer les théories du classicisme structurel. Le matériau retenu est le béton et le plan général est une trame orthogonale. Officiellement, la reconstruction s’achève au milieu des années 1960.
 Nous découvrons la façade de l’Hôtel de Ville avec ses colonnes et les dimensions chères à Perret. Nous parcourons ensuite l’avenue Foch afin de retrouver les bas-reliefs de chaque groupe d’immeubles.
Nous découvrons la façade de l’Hôtel de Ville avec ses colonnes et les dimensions chères à Perret. Nous parcourons ensuite l’avenue Foch afin de retrouver les bas-reliefs de chaque groupe d’immeubles.
 Pour finir, nous entrons dans l’église St Joseph. La lumière extérieure illumine les vitraux, les couleurs resplendissent dans cet édifice impressionnant.
Pour finir, nous entrons dans l’église St Joseph. La lumière extérieure illumine les vitraux, les couleurs resplendissent dans cet édifice impressionnant.
La visite s’achève et nos pieds fatigués apprécient le trajet en tramway du retour !
Une visite riche en information. Nous avons tous pris des notes pour nos recherches. Ils nous restent plus qu’à approfondir l’histoire de la ville pour nos projets !